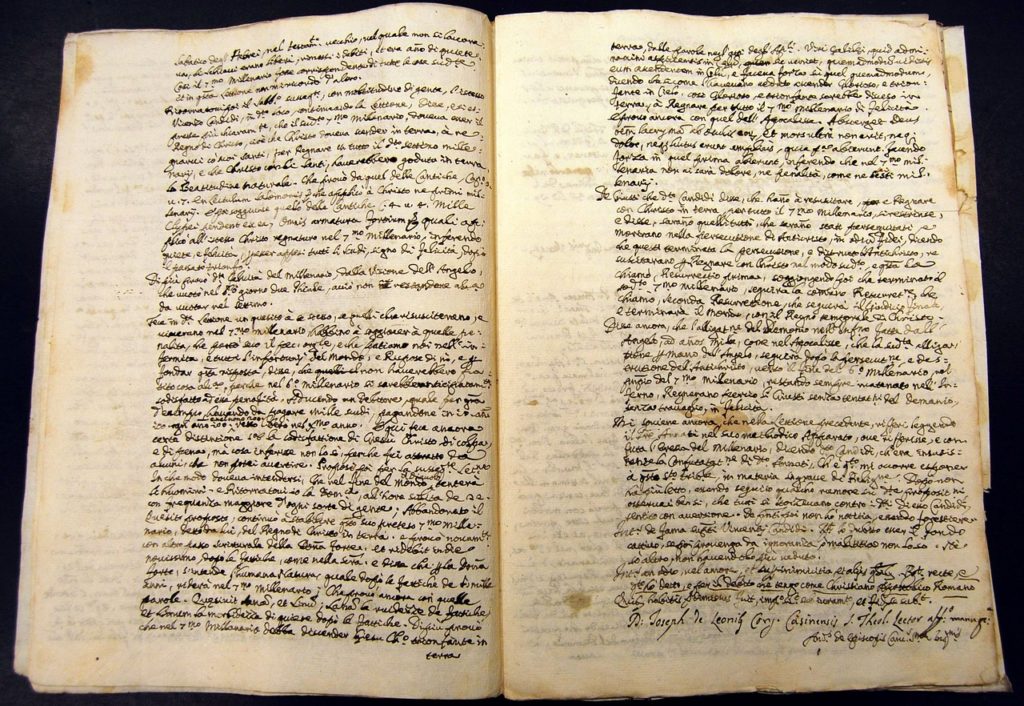Le métier de traduire exige des dispositions singulières.
Quand il parle, Jean Guiloineau charrie, moraines des souvenirs, la lucidité de l’enfance et la sensibilité du guetteur. Quand il écrit, c’est un fantôme autant qu’un frère, un compagnon de route : il interprète les écrivains venus d’ailleurs. Il doit, dans certaines circonstances, agencer d’une façon différente l’édifice de leurs paragraphes ou la fulgurance de leurs images. Non pour s’immiscer dans leur jeu, mais pour leur être fidèle. Et comme par enchantement, il est ainsi fidèle à lui-même. Avez-vous lu le « Perroquet de Flaubert » ? « Une saison blanche et sèche » ? « Un long chemin vers la Liberté » ? Julian Barnes, André Brink et Nelson Mandela s’expriment en Français grâce à notre interlocuteur. Jean Guiloineau pratique un art tout de souplesse et de persévérance. Il est traducteur.
«J’ai traduit sans doute près de cent trente livres, explique-t-il. C’est un métier que j’ai commencé d’exercer par hasard, il y a plus de quarante ans, à l’issue d’un séjour en Chine au cours duquel j’avais réécrit des textes classiques de ce pays qu’un groupe d’écrivains contestataires avaient rédigés dans notre langue. J’avais beaucoup aimé ce travail. On m’a proposé de réaménager un roman chinois précédemment traduit en Français ; j’ai accepté, cela s’est bien passé, à partir de là, tout s’est enchaîné. » Traduire oblige à comprendre, mieux que le sens profond d’un roman, les intentions d’un créateur. Il implique une science de la mesure: quand deux mots s’entrechoquent, il est bon de faire naître la même dissonance dans un autre langage, mais il ne faut pas perdre non plus ce que l’on nomme le fil du discours, l’organisation générale du propos. L’infiniment grand se conjugue au microscopique.
Bien à l’abri dans sa tanière, un écrivain fait vivre ce qui lui passe par la tête, ce qui lui chante. Le traducteur est contraint de s’adapter pour mieux l’adapter. Ce jeu de cache-cache tourne à l’intime. A force de traduire un auteur, on devient son ami, même si jamais on ne le rencontre. Il arrive aussi que l’amitié vraiment surgisse entre l’écrivain d’origine et son traducteur. Elle provoque des échanges. « Dans l’un des romans d’André Brink, un jeune homme noir n’éprouve le sentiment de liberté que grâce à un cheval avec lequel il galope, évoque Jean Guiloineau. Un jour de grande colère contre son propre statut, le garçon fouette son cheval et celui-ci accepte l’injustice parce qu’il perçoit qu’elle ne lui est pas vraiment destinée. Tandis que j’écrivais la traduction du livre, ce passage m’a rappelé l’analyse que Michel Foucault faisait du comportement du paysan normand dans « Moi Pierre Rivière… ». J’en ai fait la remarque à André Brink, lequel a lu l’ouvrage de Foucault, puis, bouleversé par l’analogie des deux situations, a réécrit son chapitre pour l’édition française ! »
Traduire permet de vérifier qu’il existe une condition humaine, une destinée commune aux êtres qui souffrent. Mais l’exercice impose à chaque pas de s’élever au-dessus des contingences grammaticales. « Un roman de Toni Morrison s’intitule Song of Solomon, explique Jean Guiloineau. Il fut édité une première fois sous le titre La chanson de Salomon, parce qu’il raconte l’histoire d’un jeune noir américain qui, retournant dans son village d’origine, au sud, entend une petite fille qui fredonne une chanson. Quand j’ai retraduit le livre, je l’ai baptisé Le chant de Salomon, parce que j’ai considéré qu’au-delà d’une ritournelle, c’est bien du Cantique des cantiques et du roi Salomon qu’il s’agissait. Toni Morrison donne à comprendre la lecture que les noirs américains, au début du vingtième siècle, se faisaient de la Bible- et que l’on retrouve dans certains Spirituals, tels que Nobody Knows.»
En écoutant le traducteur, on songe à l’armée de biblistes qui, d’un siècle à l’autre, ont transcrit dans une langue vernaculaire les versets du Livre. Mais Jean Guiloineau nous invite à dépasser cet élan, à réfléchir encore un peu plus loin que le bout de notre nez. « Connaissez-vous Victor Hugo ? questionne-t-il. En marge de l’ouvrage qu’il consacre à Shakespeare- dont son propre fils traduisait l’œuvre complète, le poète a dit l’essentiel au sujet de notre métier. »
La curiosité piquée, nous voici plongeant dans des volumes rares. A chaque mot, le verbe hugolien nous oblige. Comme toujours avec lui, c’est l’Esprit qui souffle. On ne peut pas tout citer. Mais à propos des traducteurs, on choisit cet extrait : « Ils font ce qu’ils peuvent. S’ils ne vous disent pas tout, c’est moins leur faute que la vôtre. Ce n’est pas le public qui fait le poète, mais c’est le public qui fait le traducteur. Les traducteurs ont un aïeul illustre, Moïse. Nous acceptons ce fait contesté, comme nous acceptons toute l’histoire, contestable, elle aussi, à peu près partout. Moïse est révélateur sous les deux espèces ; sur l’Horeb il est traducteur de Dieu, dans la Bible, il est traducteur de Job. Hé bien, ce traducteur puissant n’est pas libre. Quoique Moïse et parce que Moïse. Il ne peut donner au peuple juif toute la téméraire mise en scène du ciel, de Dieu et de Satan, telle que Job l’avait imaginée. Le traducteur Moïse adoucit, abrège et retranche, l’arabe se permettant ce que l’hébreu n’ose risquer. Job est expurgé par Moïse. Le traducteur, en effet, subit son milieu. Le traducteur a pour collaborateur le moment donné. Aux intelligences encore peu ouvertes, il faut des demi-traductions comme il leur faut des demi-religions. Aux intelligences adultes et arrivées à la complète croissance, il faut tout le texte, de même qu’en religion il leur faut tout le logos. La jupe d’Isis ne se lève pas aux enfants. Quand vous serez grands, quand vous serez des hommes pour de vrai, quand vous serez des peuples sachant qui vous êtes, on vous dira tout. » Victor Hugo, hélas ?