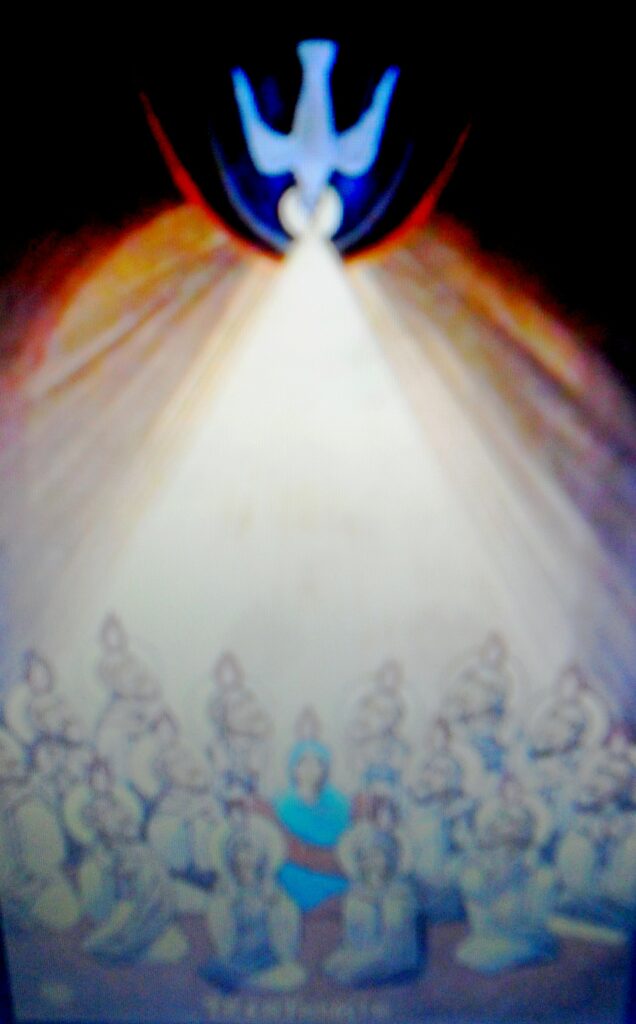Pour le week-end de Pentecôte, voici quelques propositions de lectures.
Cerf-volant des êtres qui nous ont quittés mais qui demeurent en nous, signe fugace au détour d’un murmure, quel est le sens de la Pentecôte ? Une couleur, un don ? Une grâce avant tout. L’Esprit Saint nous innerve-t-il à chaque pas ? Depuis la Chute, il n’est pas sûr que l’on puisse croire aux miracles. Mais garder l’espérance, oui. Voilà pourquoi les livres sont si précieux. Leurs pages tournent les portes de notre imagination, serviteurs fidèles au château de nos souvenirs.
Le saviez-vous ? Napoléon n’est plus. Pour célébrer l’événement, le Musée de l’Armée présente un splendide album qui porte ce titre – paru chez Gallimard (308 p. 35 €). Les plus grands spécialistes, à commencer par le juvénile Jean Tulard– quatre-vingt-sept ans, l’esprit toujours espiègle et précis– donnent à cet ouvrage illustré le bel aspect d’une malle à trésors. On y trouve des arbres– généalogiques– des archives– tantôt célèbres, tantôt rares, étonnantes– enfin des gravures et des rapports médicaux– vous serez incollables bientôt sur le mercure et les masques mortuaires.
En songeant à la nouvelle de la disparition de l’ogre mangeur d’homme ou du génie– c’est à vous de choisir– une jeune historienne, corse et cependant joyeuse, a conçu l’une des remarquables études de l’année. Marie-Paule Raffaelli-Pasquini cherche à comprendre comment la figure du Christ a pris place dans l’imaginaire napoléonien. Elle constate que Bonaparte a fait renaître la sacralité du pouvoir, elle décrit le processus d’identification par lequel, aux yeux de ses concitoyens, le militaire vaincu se pouvait confondre avec le natif de Bethléem. « Napoléon et Jésus, l’avènement d’un messie », (Le Cerf 262 p. 20 €) vaut vraiment le détour.
On vous entend déjà vous indigner, prendre votre plus belle plume, écrire avec fureur qu’il est inadmissible que Regards Protestants tolère une ligne de plus à propos du Petit Caporal. Quelques uns peut-être s’imaginent que l’auteur de ces lignes, quand il était tout jeune, rêvait de gloire au pont d’Arcole, à Wagram, Austerlitz ? Erreur. Adolescent, son plus cher désir était de rencontrer, dans un train filant vers un nord-ouest aux soleils sublimes, une voyageuse blonde aux yeux bleus, tailleur noir et sourire de soie, qu’il aurait aimé séduire en un regard… « Tout le monde veut être Cary Grant. Même moi, je veux être Cary Grant » avait déclaré l’acteur principal de La mort aux trousses. L’universitaire Martine Reid a décidé de se pencher sur la question. Le résultat ne manque pas de sel et de soufre : « Être Cary Grant » (Gallimard 156 p. 16 €) nous plonge dans les abîmes d’un artiste en quête de sa propre identité.
« Quand il débarque dans la capitale du Cinéma, le jeune homme à vingt huit ans, écrit-elle. Il mesure un mètre quatre-vingt-sept et possède un physique généralement jugé avantageux. Arrivé aux États-Unis en 1920, il ressemble davantage à un cabot qu’à un acteur véritable, même s’il ne connaît pas d’autre métier que celui de la scène. Son identité se perd dans une succession de postures et de comportements incertains, à l’image de sa brève enfance à Bristol. »
Archibald Leach est devenu Cary Grant, mais le feu de l’incarnation n’a jamais pu faire disparaître les tragédies de ses primes années. Résultat de ces intenses tourments: l’inadaptation de l’homme au destin de l’artiste, en dépit des séjours en hôpital psychiatrique et des prises de LSD. Si c’est cela, on préfère écrire des articles. Il n’empêche, Eva Marie-Saint…