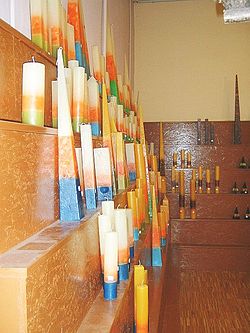Aumôniers chrétiens en prison, nous sommes alarmés par le débat lancé contre les activités « ludiques » en détention.
Nous publions une tribune parue dans le journal La Croix, intitulée Activités ludiques en prison : les aumôniers dénoncent « un débat injuste et contre-productif » dans sa version internet du 25.02.2025 et intitulée Le débat sur les activités ludiques en prison est injuste dans sa version papier du 03.03.2025. Elle est signée par Mgr Marc Alric, le pasteur Philippe Aurouze et Bruno Lachnitt, tous trois aumôniers en prison, ils nous invitent à nous mettre à l’écoute de ceux qui vivent la réalité pénitentiaire au quotidien.
Il nous semble injuste et contre-productif. Injuste parce que le mot employé est impropre, désignant une activité visant à restaurer l’estime de soi et ayant répondu à un appel à projets de l’administration pénitentiaire. Le légitime besoin de sécurité exprimé par nos concitoyens est aujourd’hui prétexte à une surenchère, un cercle vicieux qui génère paradoxalement plus d’insécurité, de tensions.
Tous les acteurs qui interviennent dans et autour de la prison devraient partager le même objectif : accompagner chaque personne détenue vers le meilleur d’elle-même et vers sa réinsertion. C’est le seul véritable intérêt de la société. Remettre en cause ce qui peut y contribuer est proprement insensé. Comment ressortiront celles et ceux qu’on oublie derrière les murs des prisons quand ils accumulent au quotidien une violence contenue dans des conditions indignes ?
Contre-productif, parce qu’à l’heure où nous battons chaque mois de nouveaux records en matière de surpopulation carcérale (80 669 détenus dont 4 310 matelas au sol pour 62 385 places), nous sommes témoins au quotidien de la souffrance qu’elle génère non seulement chez les personnes détenues dans des conditions indignes, mais aussi chez les personnels de surveillance qui sont mis à mal dans des conditions de travail difficilement supportables. Au-delà des discours convenus sur le sens de la peine, il est de fait que la surpopulation actuelle contribue à lui ôter toute valeur.
Si la prison est déjà loin de n’être comme le disait, en son temps, le président Giscard d’Estaing que « la privation de la liberté d’aller et venir, et rien d’autre », le chemin vers un avenir sans récidive passe par l’estime de soi et la confiance. Comment peut-on raisonnablement imaginer que les personnes détenues ressortent différentes si on ne cesse de les identifier à ce qui les a conduites en prison ?
Dans ce climat difficile, on espérerait que les politiques contribuent à informer l’opinion plutôt que de la suivre, à poser les conditions d’un débat éclairé plutôt que d’engager de mauvais procès contre les acteurs de terrain qui manquent de moyens pour remplir leur mission. La prison concentre toutes les contradictions de notre société et celles et ceux qui y œuvrent à quelque titre que ce soit ont plus besoin de soutien et de solidarité que de suspicion.
Accompagner les personnes détenues vers le meilleur d’elles-mêmes, c’est l’engagement constant de nos aumôniers, forts de la foi et du respect de chaque personne qui les animent. Nous invitons toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à se mettre à l’écoute de celles et ceux qui vivent cette réalité au quotidien à un titre ou à un autre, pour construire ensemble une réflexion partagée, et sortir d’une fuite en avant qui met à mal la société tout entière.
Mise en perspective / explications sur les activités en détention :
Le Code pénitentiaire est très clair sur la raison d’être des activités proposées aux personnes en détention. En effet, « Toute personne détenue condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui sont proposées par le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité sa réinsertion… (Art. L. 411-1 du Code pénitentiaire). Un jour ou l’autre, le détenu sortira. Comment la société l’aura-t-elle aidé ?
C’est pourquoi, en proposant des activités, l’administration pénitentiaire ne fait que respecter le droit. «Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l’animation de certaines activités. L’emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités. » (Art. D. 414-3) Il en va de même pour les activités sportives (Art. D. 414-8). Les activités sont donc un droit, participant au bien-être et à l’occupation structurée du temps en détention. D’ailleurs l’accès aux activités peut être considéré comme un facteur de prévention des troubles psychiques et des violences en détention.
Les activités proposées par des associations permettent un pont avec l’extérieur. Mais, avant de pouvoir entrer en détention, ces associations doivent démontrer le lien entre leurs activités et la réinsertion sociale et/ou la prévention de la récidive. Tout est donc soigneusement contrôlé par l’administration qui doit respecter la législation. D’ailleurs « pour l’animation d’activités par des personnes extérieures, l’autorisation est donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. » (Art. D. 141-4).
Les personnes détenues ont les droits civils, civiques, économiques, sociaux et culturels qui ne leur sont pas expressément retirés par la loi. Un livret d’accueil leur permet d’être informé, entre autres, sur les activités (Art. L. 311-1) Il y est fait mention du droit à la culture, à l’éducation, au sport et à la spiritualité (d’où les aumôneries). L’accès aux activités est un droit, non une faveur.
« Rétablir le sentiment que la justice est juste, reconstruire la dignité des personnes détenues passerait par une mobilisation, non pas de toute l’administration pénitentiaire, mais de toute la société ; c’est en effet la société qui, par l’intermédiaire de ses représentants, agit pour rendre digne en réintégrant ses membres dans le cercle des êtres dont la parole compte. Reste à savoir plus précisément quel serait le coût à payer -par notre société dans son ensemble et par ses membres considérés individuellement- pour rétablir des relations interpersonnelles d’une qualité telle qu’elles puissent rendre leur dignité à ceux qui en ont été privés par leurs conditions d’incarcération. » (Benjamin Levy in Cynthia Fleury, Clinique de la dignité, 2023, p. 212)